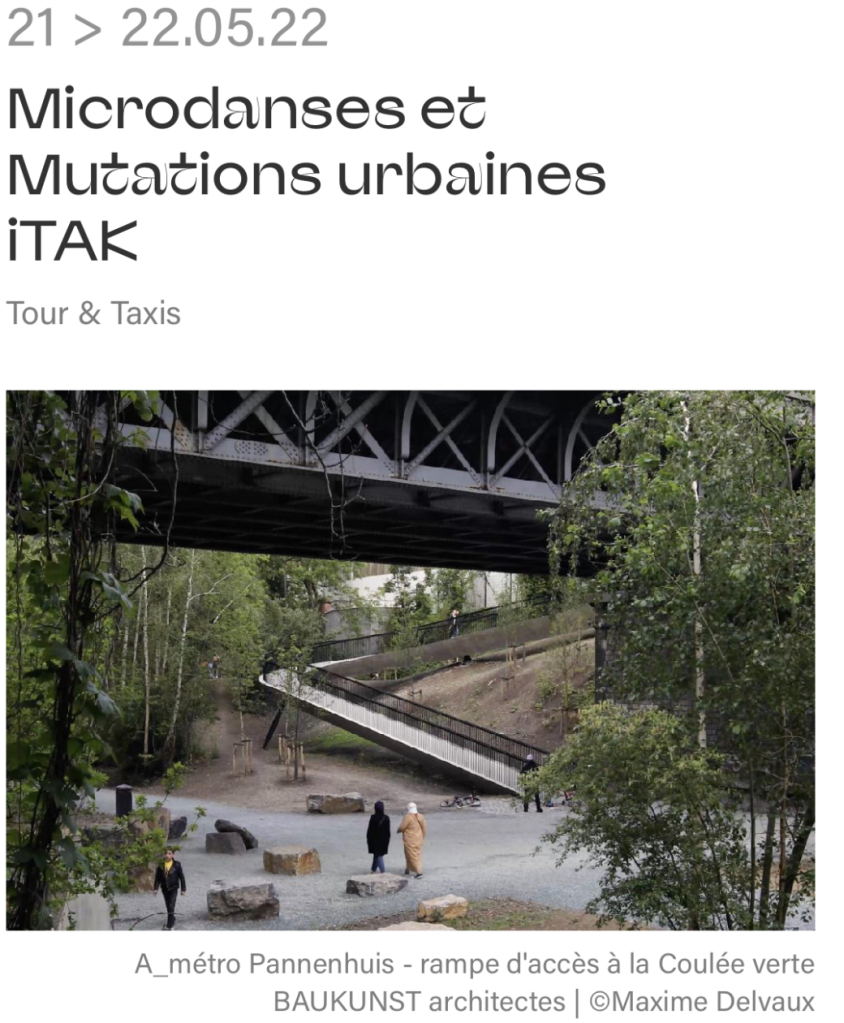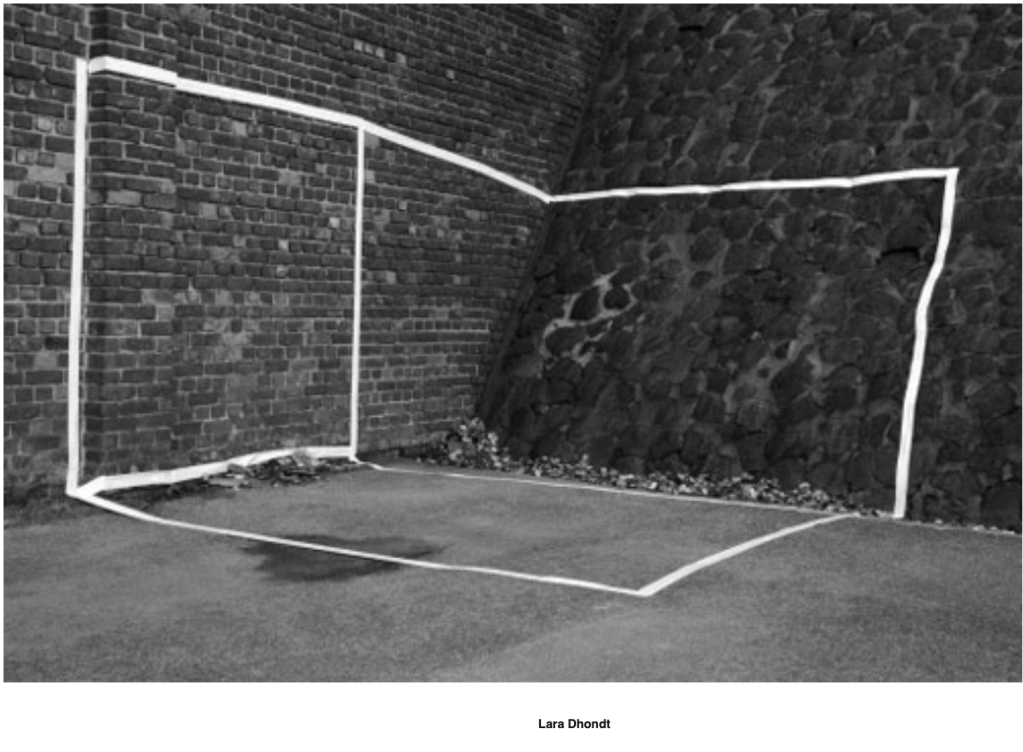17 mai 2024 midi minuit
Latitude 50
3 talks + 3 ateliers + 1 cabaret
- 12h – 13h30 table ouverte au bistro ou apporter son pique nique
- 13h30 – 19h 3 talks & 3 ateliers
- 19h – 20h table ouverte (sur réservation)
- 20h30 Cabaret Cirque
Je vous invite à découvrir des architectures saltimbanques, démontables et légères comme les bancs et les tréteaux d’autrefois, au croisement de l’art, de l’architecture et de l’activisme, visant une réalité humainement augmentée.
Cette promenade permettra la rencontre assez rare entre des architectes, des artistes et des organisateurs de projets artistiques en espace public.
Une journée pour les architectes, circassiens, performers, danseuses, constructeurs, apprenties, bâtisseuses, tisseur de ville, curators de festivals, programmateurs transversaux, urbanistes, cellules événementiel de commune, coordinatrices d’espaces publics, collectifs et curieux.
Programme concocté par Vincent Geens & Pauline de La Boulaye avec Horst Arts & Music, Laboratoire architecture, collectif Dallas, Rotor, Le Botanique
Cette journée professionnelle s’inscrit dans le cadre de l’année Nouveaux cirques. Nouvelles architectures. Un projet de Latitude 50 en collaboration avec l’Université Libre de Bruxelles, l’Université de Berlin, UCLouvain (LOCI-Tournai), la Cellule Architecture de la Fédération Wallonie-Bruxelles, l’Institut Culturel d’Architecture Wallonie-Bruxelles, Circostrada, La Roseraie, la Commune de Marchin.